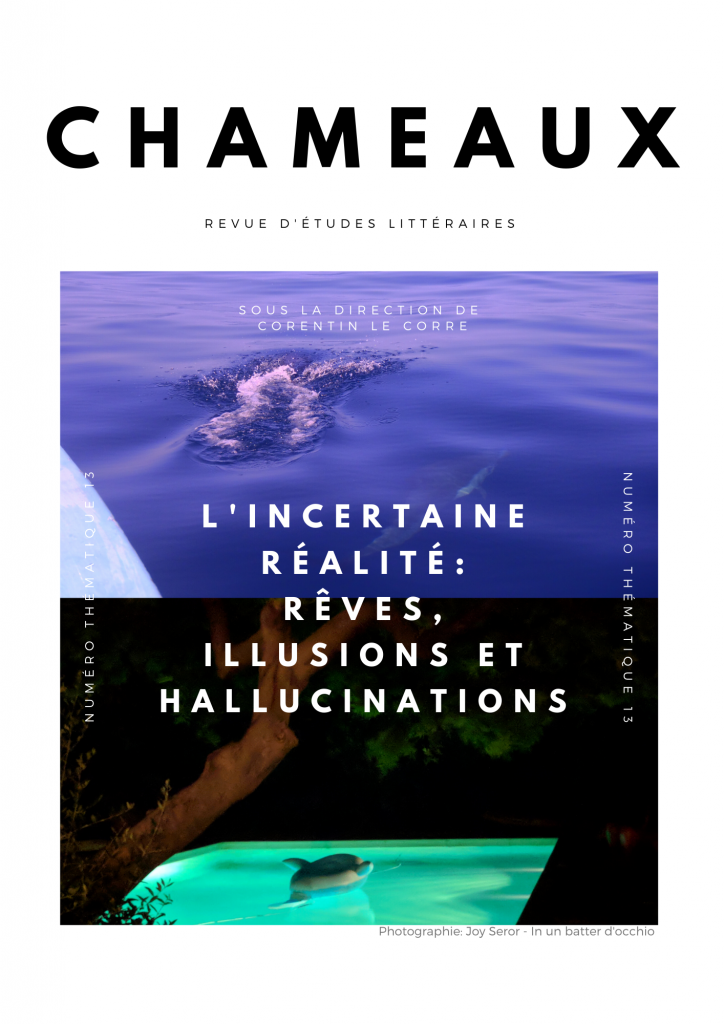
Quelle vertigineuse impression nous assaille lorsque l’un de nos sens a été trompé. Quel étrange émoi nous parcourt au moment où notre pied rêvé manque une marche imaginée, nous réveillant, le front perlé de sueur, dans une pièce que nous ne reconnaissons pas encore comme la chambre à coucher. Que dire de cette cruelle trahison poussant notre œil à dessiner une oasis au cœur d’une plaine ignée ? L’ombre flottant au plus malicieux faubourg de notre vision ; le vent claquant des volets clos, formant l’étrange écho d’un éclat d’outre-tombe ; le portrait d’un être cher déposé sur le visage d’un autre. Une certitude émane alors : la réalité est incertaine. Elle est déformée par ce que nous appelons illusions, hallucinations, rêves. En somme, c’est par notre propre esprit qu’elle est déformée, piégée par des sens humains ne pouvant cerner toute la complexité du monde et des espaces qui le bordent de leurs étoiles. Pourtant, parfois, la vérité se trouve par-delà ces portes entrebâillées de l’ailleurs, dans l’univers de ce qui nous est caché, celui où le fantasme est Maître.
L’incertitude quant au réel peut naître, se manifester et se vivre d’une infinité de façons. De nombreux écrivains, cinéastes, développeurs, plasticiens, musiciens ont choisi d’explorer cet entre-deux mondes. Par conséquent, ces derniers brouillent leurs propres œuvres, leurs propres récits, afin de piéger le lectorat ou le public dans cet espace particulier, incapable de distinguer le réel de l’illusion, ce qui le mène fatalement à s’interroger quant à sa propre condition. Pour ce faire, là encore, il y a mille manières de s’y prendre. Au cinéma, par exemple, avec un cadrage inspirant lui-même une sensation d’étrangeté en formant un subtil décalage : c’est ce que propose Ingmar Bergman dans plusieurs de ses œuvres, Persona en tête. Ou alors, plonger les personnages dans des sortes d’univers parallèles en fractionnant le métrage en fonction de divers codes esthétiques et atmosphériques, propres aux hallucinations ou à l’onirisme. Le réalisateur Terry Gilliam s’est attelé à cette pratique dans la plupart de ses films, faisant se perdre ses protagonistes dans des labyrinthes échappant à notre perception du monde objectif. Martin Villeneuve, dans Mars et Avril, fait se croiser l’onirisme et le réel, brouillant les frontières grâce au montage, à certaines techniques de superpositions d’images n’étant pas sans rappeler le surréalisme d’un Luis Bunuel dans Un chien Andalou, ou encore d’un David Lynch. Ce dernier a, par ailleurs, et ce depuis ses premiers essais cinématographiques, bien avant Twin Peaks ou Mulholland Drive, pris comme sujet l’interpénétration entre réalité et surnaturel. Comme le peintre Francis Bacon, il trouble le public dans sa propre chair en lui donnant le rôle d’un funambule penchant entre le connu et l’inconnu, et notamment en travaillant le corps. Troubler le public en troublant le monde. Il s’agit véritablement d’un subtil numéro de funambulisme, à la manière de celui guidant les pas de flâneurs citadins tels que Jacques Réda ou André Breton, cherchant les signes du merveilleux dans la ville. Des signes qui peuvent être issus d’un folklore, d’une mythologie, qui feraient basculer le réalisme dans une atmosphère propre au surnaturel, celle que côtoie le James Bond de Ian Fleming dans moult de ses aventures. Ces signes bouleversent les perceptions du réel, créant parfois une oscillation des genres littéraires eux-mêmes, à la manière de la poésie d’Elizabeth Bishop, constamment dans un entre-deux étrange.
Des signes qui bouleversent les perceptions du réel. Parfois, nous les cherchons pour qu’ils nous nourrissent, qu’ils alimentent nos phrases, nos idées, nos mots. Nous les cherchons en nous-même. Puis, dans certains cas, nous nous tournons vers des médiums qui se permettent de déranger les fantômes. Nos fantômes. Dans d’autres cas, on ne les cherche pas. Ils viennent à nous. S’imposent à nous. Ils nous apparaissent, comme Lola Abba est apparue à René Char. Ils nous forcent à reconsidérer notre rapport au monde, à lever le voile devant nos yeux afin que nous fassions connaissance avec une autre vérité, peut-être la vérité. Ainsi, les personnages de H.P. Lovecraft sont tourmentés jusque dans leurs rêves pour s’ouvrir à un univers où l’humanité serait encore plus de l’ordre du détail qu’elle ne l’est déjà. De fait, leur façon d’être au monde est remise en question, tout comme celle des protagonistes de Christopher Nolan dans ses premiers films, lui-même opacifiant le rapport à la réalité. Dans le cas de H.P. Lovecraft, la découverte du vrai est à tel point terrifiante qu’elle mène à la folie, et il vaut mieux ne pas souhaiter se libérer du douillet mensonge dans lequel se love l’humanité. Mais parfois, l’esprit révolutionnaire est trop fort pour laisser cette dernière se conforter dans le mensonge, dans une réalité qui serait créée de toute pièce, comme dans le mythe de la caverne érigé par Platon. Alors, il s’agit de lutter pour faire éclater la vérité, à la manière des deux personnages principaux du jeu vidéo Enslaved : Odyssey to the West, cherchant à libérer le peuple, asservi par l’illusion créée par un dispositif de réalité virtuelle.
À travers quatorze sujets extrêmement variés dans les médiums traités comme dans les thématiques, le présent numéro se penche, ou plutôt s’engouffre, car il ne se contente pas de rester au bord du précipice, dans ce vertige né de l’inquiétante porosité entre réel et irréel (pour peu que ce que nous désignons comme tel ne soit pas une réalité qui nous échapperait).